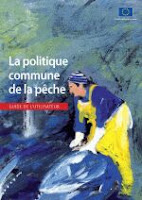La 4ème Rencontre Internationale du Réseau Océan Mondial Agir ensemble pour l’avenir de la Planète Bleue s’inscrit en 2010 dans l’Année Internationale de la Biodiversité.
Elle se déroulera à Boulogne-sur-Mer, du 9 au 12 mai 2010, à Nausicaá, Centre National de la Mer, à l’initiative du Réseau Océan Mondial, coprésidé par Philippe Valette, Directeur Général de Nausicaá
Après un bilan des actions d’information et d’éducation menées ces dernières années sur l’utilisation durable de l’océan, les participants de la 4ème Rencontre Internationale élaboreront une stratégie pour étendre la mobilisation des citoyens et du public à toutes les régions du monde.
Le programme provisoire comprend une présentation globale de la Rencontre, la liste provisoire des ateliers et le programme de l’Académie de l’Océan Mondial. Voir ICI le formulaire d'inscription et le programme provisoire de la Rencontre.
En s’inscrivant avant le 12 avril 2010 à la 4ème Rencontre Internationale, il est possible de bénéficier de tarifs plus avantageux.
Cette Rencontre fera suite à la 5ème Conférence Mondiale sur les Océans, les Côtes et les Iles, Garantir la Survie, Préserver la Vie, Améliorer la Gouvernance, les Océans, le Climat, la Biodiversité : de Copenhague 2009 à Nagoya 2010, du 3 au 7 mai 2010, UNESCO, Paris, France, à l’occasion de laquelle seront établis un état des lieux de l’Océan Mondial et des propositions pour sa gouvernance.

Rappelons également que dans le cadre de l'Année internationale de la Biodiversité 2010, Brest 2010 est la capitale maritime de la biodiversité.
Pour en savoir plus sur la biodiversité du littoral, consultez également les archives des entretiens Science et Ethique 2006.
Contacts : World Ocean Network / Réseau Océan Mondial
c/o Nausicaá, Centre National de la Mer
Boulevard Sainte Beuve – BP 189 – 62203 Boulogne-sur-Mer Cedex France
Téléphone : 33 (0) 3 21 30 99 99 – Fax : 33 (0) 3 21 30 93 94
Website: www.worldoceannetwork.org www.reseauoceanmondial.org
E-mail : meeting@worldoceannetwork.org
Sources : World Ocean Network / RH - 3B Conseils